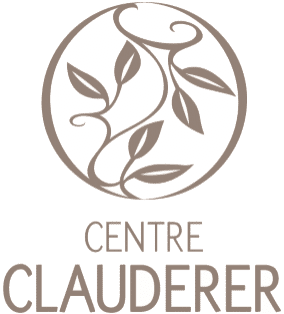Question de Lucien B.
Qu’est-ce que la DHT et quel est son rapport avec la perte des cheveux et les hormones androgènes ?
Réponse Clauderer
La DHT (dihydrotestostérone) est une hormone de la famille des androgènes. La sécrétion de cette hormone naît de la rencontre de l’enzyme 5-alpha réductase avec les androgènes qui circulent normalement dans le sang. Ce nouvel androgène DHT, beaucoup plus puissant que les androgènes normaux est à l’origine de la chute de cheveux dite androgénétique, chez l’homme comme chez la femme.
Dans un follicule pileux sain, l’enzyme 5-alpha réductase reste inactive. Mais dans un follicule génétiquement prédisposé, les androgènes, transformés en DHT par la 5-alpha, agissent sur les cycles de vie du cheveu. À chaque nouveau cycle, ils raccourcissent de plus en plus la phase anagène de croissance et prolongent au contraire la phase de repos télogène, retardant anormalement le départ d’une nouvelle pousse. À terme le follicule pileux se miniaturise et produit un cheveu de plus en plus mince qui devient duvet (voir le schéma ci-dessous). Puis le follicule finit par ne plus rien produire du tout : c’est la calvitie.
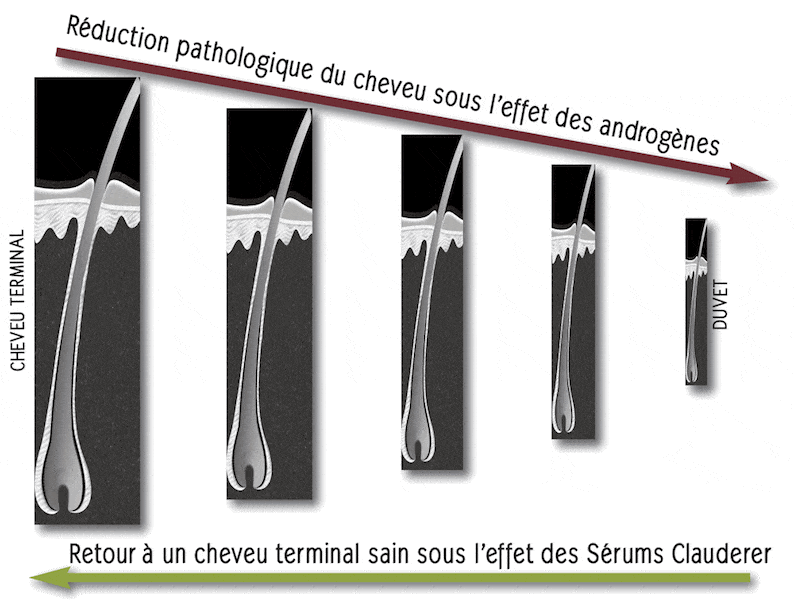
Ces méfaits générés par l’androgène DHT peuvent être annulés par les actifs végétaux anti androgènes des Sérums Clauderer 6R et 7R. Des tests in vivo ont prouvé en effet que le taux de croissance des cheveux n’était pas perturbé par les androgènes quand les Sérums Clauderer 6R et 7R étaient appliqués régulièrement sur des cuirs chevelus androgénétiques.